Mon nouveau blog
Mes nouvelles aventures (culinaires, cette fois) se passent ici.
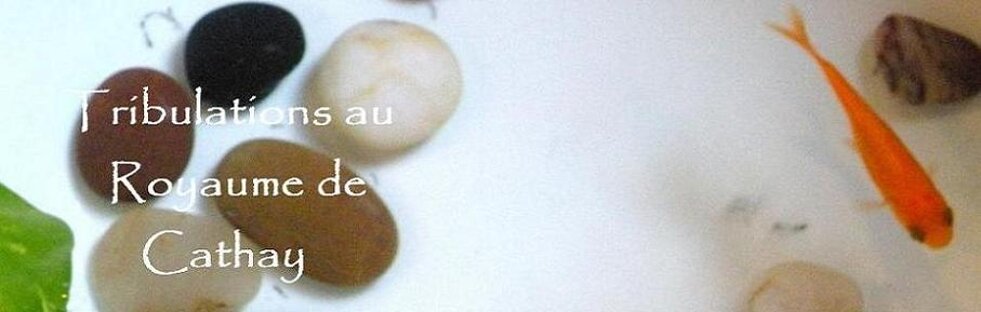
Et voilà, après un an et cinq mois à tenir ce blog, 68 messages, 8614 visiteurs et 640 commentaires, je crois qu'il est temps pour moi de fermer cette page et de passer à autre chose. Les meilleurs commentateurs, j'ai nommé Tom, Mumu et Ellebasy, qui ont fait vivre ce blog et que je remercie, recevront un petit cadeau de reconnaissance (merci aussi de m'envoyer votre adresse postale en cliquant sur "contactez l'auteur"). Les pages resteront accessibles et vous pourrez continuer à me joindre par mail. Pour ceux qui rêvaient pour de vrai de connaître la fin de l'histoire du thé, mon mémoire est disponible en .pdf si vous m'en faites la demande.
Bonne continuation à tous,
Marong
.
.
.
Partenaire de l'exposition universelle de Shanghai, mon entreprise a reçu un exemplaire de la peluche de Léon le chaton que vous avez découvert dans le quiz précédent. Depuis, ce truc circule dans tous les bureaux et fait grand débat : la France est-elle dignement représentée par cette espèce de jeune matou farceur en béret et salopette tricolore ? Comme on peut le lire sur Chine informations, "Ce chaton rond et gourmand a sept ans. Il est joyeux, vivant et
impulsif, ce qui l'amène à faire des bêtises. Il est toujours prêt pour
l'aventure et la découverte du monde. Il suit les rituels des enfants :
le bain, le goûter, les anniversaires mais toujours en faisant des
bêtises : il oublie de fermer le robinet. C'est Léon, le chaton, joyeux
et farceur qui interagira avec les visiteurs du Pavillon France."
Le Français moyen, ce chaton ? Je suis un peu sceptique. Tant qu'à bâtir sur un cliché, j'aurais préféré celui du "chic français" ou du romantisme. De plus, pour une exposition universelle sur le thème de l'habitat durable, je ne suis pas sûre qu'un gamin qui oublie de fermer le robinet soit le meilleur ambassadeur. Même si j'apprécie que les petites peluches de la mascotte soient de très belle pièces en bois et tissus estampillées "Made in Jura" et dont la qualité est irréprochable.
Votre avis ?
.
Après un joyeux fou-rire sur le blog de l’inégalable Estèbe, j’ai décidé de me mettre moi aussi à la rédaction de quizz tordus et de tester vos connaissances sur la Chine. Ça tombe bien, je suis justement débordée et fatiguée, j’ai un mémoire à finir et un comité stratégique à préparer, c'est une occasion unique de procrastiner pour finir paniquée et stressée ce week-end. Youpi !
(Inutile de googliser les réponses, elles sont à la fin avec des liens hypertextes de ouf !)
.
1 - L’ingrédient
magique qui donne toute sa saveur au 古老肉, le porc chinois à l’ancienne est :
A. le poivre du Sichuan
B. la confiture de myrtille
C. le gingembre
D. le ketchup
2 - La Cité
Interdite est surplombée par une colline, qui permet d’équilibrer les forces de
l’eau (rivière qui traverse le palais) et de la terre (ladite colline). Cette
colline porte le nom de…
A. Colline de granit
B. Colline de charbon
C. Colline de l’uranium
D. Colline de la longévité éternelle et de la
paix reposante au petit matin.
3 - L’une de ces
chansons française est extrêmement connue en Chine, ce qui n’arrange pas
l’image de la culture française à l’étranger. Laquelle ?
A. Je m’appelle Hélène, de la chanteuse
éponyme.
B. L’aigle noir, de Barbara
C. Le petit bonhomme en mousse, de Patrick
Sébastien
D. Le curé de Camaret, de je sais pas qui.
.
4 - Même si les Chinois s’habillent bigrement n’importe comment, le code couleur compte encore ! Il est d’ailleurs fortement déconseillé de porter un chapeau vert, qui signifie …
A. que l’on est un propriétaire terrien
bourgeois
B. que nos parents étaient des opposants aux régimes
C. que l’on a des poils aux jambes
D. que notre épouse n’est pas du genre fidèle
5 – L’une de ces
pages internet n’est pas bloquée en Chine. Youpi ! On peut naviguer
librement sur :
A. Dailymotion
B. Tribulations
au Royaume de Cathay
C. Amazon
D. La bouche
pleine, journal d’une gourmande
6 – L’expression
chinoise 吃醋, qui signifie « être jaloux »,
est assez imagée. Littéralement elle signifie…
A. Croquer du
piment
B. Grignoter des
pattes de poulet
C. Boire du saké
D. Manger du
vinaigre
7 – On m’a dit un
jour que 70% de la population chinoise se partage 12 noms de famille. Quel est
le plus courant ?
A. Wang
B. Cohen
C. Li
D. MacDonald
.
8 – Les Chinois
sont moqueurs vis-à-vis de leurs compatriotes expatriés. Ils leur prêtent le
surnom de …
A. Radis (rouges
dehors, blancs dedans)
B. Bananes (jaunes
dehors, blancs dedans)
C. Noix de coco
(forts à l’extérieur, creux dedans)
D. Artichauts
(juste pour être méchants)
9 – L’un de ces
temples chinois sort de mon imagination…
A. Le temple des
grands pandas
B. Le temple du
cheval blanc
C. Le temple de
la vache
D. Le temple des
lamas
10 - Le Grand
Bond en avant est :
A. Une figure de kung-fu
B. Un plat aromatique à base de lapin
C. Une politique économique inspirée par Mao
D. Un mec aux cheveux clairs super mignon
juste devant vous dans la file d’attente
11 – Zheng He,
célèbre amiral chinois, a fait des découvertes maritimes fabuleuses. Ses
récits, retracés par Ma Huan, furent consignés dans un recueil intitulé :
A. Tribulations
d’un Chinois hors de Chine
B. Merveilles des
Océans
C. Pékin-Aden
D. Martine à la
plage
12 – Pourquoi ne
trouve-t-on aucun Chinois capable de témoigner de son expérience de dégustation
de chair de panda ?
A. Parce que la
chair de panda n’est pas comestible et que ceux qui l’on goûtée n’ont pas
survécu
B. Parce que c'est
tellement mignon que quand on voit le panda on se met à chanter « Mon ami
Tortoro » à tue-tête et on a envie de tofu
C. Parce que c'est passible de la peine de mort
D. Parce que les
pandas ont complètement disparu depuis 10 ans et que les rumeurs sur le fait qu’ils
sont en voie de disparition est un complot du WWF pour vous faire donner de l’argent
à la sortie du métro
13 – La mascotte
française de l’exposition universelle de Shanghai est une petite peluche qui représente :
A. Bébert, le
pigeon grognon
B. Kozy, le
Président facétieux
C. Emile, le coq
ronflant
D. Léon, le chaton gaffeur
14 – Un amoureux
de la Chine est un :
A. Cynophile
B. Sinophile
C. Cinéphile
D. Signe et file
.
.
.
.
.
.
Réponses : 1-D, 2-B, 3-A, 4-D, 5-B, 6-D, 7-C, 8-B, 9-A, 10-C, 11-B, 12-C, 13-D, 14 -B
Vous avez droit à 1 point par réponse correcte.
O point : Non, sans blague ?
1 à 5 points : Il serait temps de faire un petit tour à Pékin pour progresser un peu et acquérir quelques bases !
6 à 13 points : Pas mal !
14 points : Bravo
Plus de 14 points : t'as forcément triché ...
Beaucoup d’ouvrages
sur le thé s’appliquent, en quelques lignes, à expliquer comment infuser une
tasse de thé selon les principes du thé gongfu.
On lira chez certains auteurs qu’il faut mettre 4g de thé dans sa théière,
d’autres expliqueront que l’eau doit être chauffée à 85°C. C'est ignorer
entièrement les principes du gongfu cha
qui prônent par-dessus tout l’expérimentation. Kakuzô Okakura, dans le livre du
thé, n’évoque pas une seule fois les différentes techniques de préparation. Les
inévitables erreurs et incertitudes qui entourent l’infusion sont nécessaires
et acceptées. Seule la beauté ne doit pas faire défaut : « de même qu’il n’existe nulle règle fixe présidant
à la création d’un Titien ou d’un Sesson, on ne saurait produire un thé parfait
à partir d’une seule et unique recette. Chaque façon de préparer les feuilles
possède sa particularité, ses affinités électives avec l’eau et la chaleur, ses
souvenirs héréditaires, sa manière propre de raconter. Mais la vraie beauté
doit toujours rester présente. »[1]
Certes, il existe
de techniques éprouvées qui permettent à ceux qui font leurs premières
infusions d’éviter les catastrophes et le gaspillage d’un excellent thé. Mais
les recommandations de ce type doivent permettre une définition de la cérémonie
par la négative : ne pas conserver son thé dans sa cuisine, ne pas infuser
un thé vert avec une eau à 90 °C, autant de conseils qui permettent d’éviter
certaines embûches, mais pas de tracer une voie directe vers la tasse parfaite
qui exempterait le buveur de faire des essais, des recherches et des erreurs.
Les tâtonnements et le temps nécessaires pour acquérir la technique, les
fondements et les secrets du gongfu cha
sont ainsi à la base de cette pratique et en font toute sa profondeur. De nos
jours, le marché du thé propose un large éventail de qualités : il est
possible, pour un prix modeste, de s’offrir différentes sortes de thé et ainsi
de faire des essais d’infusion sans risquer de gâcher un grand cru. Cependant,
quelques gestes et principes de bases inévitables fondent la pratique du gongfu cha et il convient de rapprocher
les gestes de la cérémonie des ustensiles décris plus haut.
Prenez vos outils, puis oubliez-les
« Un
bon thé se boit dans une tasse chaude » dit l’adage. Il s’agit donc,
avant toute infusion d’ébouillanter les ustensiles. Préparer un thé à une
température étudiée pour en révéler toutes les qualités et le servir dans des
porcelaines froides gâcherait les saveurs de l’infusion. Il est donc essentiel
d’ébouillanter son service. Pour cela, on place les tasses et la carafe
l’ouverture vers le haut, le gaiwan
ou la théière sans son couvercle. Les gaiwan sont généralement ainsi fait que
le couvercle peut tenir aisément lorsqu’il est glissé entre le récipient et la
soucoupe. Quant à la théière, on peut tenir son couvercle dans la main, le
poser dans la passoire ou sur un support prévu à cet effet. Les ustensiles sont
toujours posés sur un support, remis à leur place ou gardés à la main, mais
jamais posés tels quels sur le plateau ou la nappe.
Les utilisateurs du bateau à thé pourront
se laisser aller à ébouillanter largement tout le service tandis que ceux qui
présentent leur chaxi sur une nappe
prendront soin de ne pas en mettre une goutte à coté. Par ce seul exercice, on
comprend combien la pratique du gongfu
cha sur une nappe est plus complexe que sur un bateau à thé ! Le
respect du confucianisme et des règles de bienséances veut que l’on ébouillante
les ustensiles, placés tout autour du plateau, dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre. C'est une forme de respect pour les invités :
symboliquement, remonter le temps de cette manière permet de signifier le
plaisir que l’on prend à les accueillir autour de la table, le temps dont on
dispose et que l’on est prêt à leur sacrifier. Ebouillanter son service, comme
l’introduction de toute chose, est une manière de souhaiter la bienvenue et de
rappeler que l’on souhaiterait que le temps s’arrête pour savourer cet instant
à l’infini. C'est évidemment également une manière de nettoyer son service et
de commencer à préparer son thé dans des tasses dépourvues de poussière ou de
résidus.
Il convient ensuite
de vider les tasses de leur eau, en les attrapant à l’aide de la pince qui
figure parmi les six ustensiles. On peut vider l’eau directement dans le
bateau, dans le large récipient prévu à cet effet, ou encore la verser sur les
figurines qui se trouvent sur le plateau. On place ensuite les tasses devant les
invités ou sur la nappe de façon adaptée à la position que l’on adoptera au
moment de servir. De nombreux modèles de petits plateaux pour les tasses sont
disponibles dans le commerce et permettent de disposer proprement les tasses
devant les invités. On prend ensuite le lotus, dans lequel reposent les
feuilles de thé, préalablement sorties de leurs boites à l’aide de la cuillère
et/ou du couteau et exposées sur la table de thé depuis le début de la
préparation. On profite généralement de ce moment pour faire sentir à ses
invités les feuilles de thé sèches dans le lotus. Comparer le parfum des
feuilles de thé avant leur infusion, après qu’elles aient été ébouillantées et
le parfum de l’infusion elle-même révèle de nombreuses facettes d’un même thé,
et souvent des différences surprenantes.
Faites des choix
Vient ensuite la
préparation du thé lui-même avec toutes les possibilités que cela implique. Les
choix qui seront fait à ce stade dépendent entièrement du thé qui a été
choisi : son âge, sa catégorie, sa qualité… ce sont les feuilles de thé
elles-mêmes qui président à la cérémonie du thé. Des caractéristiques des
feuilles découleront tous les paramètres de l’infusion : choix des tasses,
temps d’infusion, température de l’eau, gaiwan
ou théière… La façon de déposer les feuilles dans le gaiwan ou la théière
dépend également du thé choisi. On verse généralement les feuilles de thé dans
le gaiwan ou dans la théière vide
préalablement ébouillantés, mais certains thés verts demandent une attention
particulière et préfèrent délivrer leurs saveurs en étant versés directement
sur l’eau du gaiwan. Pour d’autres
encore, on emplit d’eau la moitié du gaiwan,
on dépose les feuilles et on recouvre d’eau. Cependant, quelque soient les
paramètres sélectionnés pour l’infusion, il s’agit d’avoir des gestes précis et
gracieux sans être maniérés, d’aller à l’essentiel avec sobriété sans être
rustre. Les gestes parasites, qui donne une sensation inconfortable de
brusquerie, sont à éviter à tout prix : on trouve dans les maisons de thé
qui emploient du personnel peu formé des serveuses qui préparent le thé avec
beaucoup de tremblements et de secousses. Lorsque l’on vide la théière par
exemple, il est important de ne pas laisser d’eau au fond, sous peine de
continuer à infuser le thé. Il est alors important de remuer légèrement le thé
dans la théière ébouillantée après l’y avoir placé. Il est souvent tentant à
cet instant de secouer la théière pour en faire sortir les dernières
gouttes ou réchauffer les feuilles : un défaut très stressant pour
l’invité car il nuit à l’harmonie et à la sobriété des gestes.
Après avoir infusé
le thé dans la théière ou le gaiwan,
il convient de verser son contenu dans la cruche ou, comme on l’a vu plus haut,
pour les téméraires, directement dans les tasses. La température très élevée de
la porcelaine et de la théière rend cette opération assez délicate. Après avoir
été ébouillantée, puis avoir reçu l’eau de l’infusion pendant plusieurs
secondes, voire plusieurs minutes, les parois du gaiwan et de la théière sont extrêmement chaudes et il peut
s’avérer périlleux de l’attraper à la main. Pas d’autres choix pourtant, et il
s’agit alors de trouver une position des mains gracieuse et stable, permettant
de verser le thé sans prendre le risque ni de se brûler, ni de laisser échapper
la théière. Les personnes expérimentées préfèreront tenir leur théière à une
seule main, tenant l’anse entre le majeur et le pousse et retenant le couvercle
en posant l’index sur le bouton mais il n’existe aucune règle rigide régissant
cette question et il est important d’adopter la position la plus confortable et
la moins dangereuse.
Aiguisez vos sens
Lorsque l’on
prépare du thé en utilisant des tasses à parfum, on verse le thé dans ces
tasses en premier. C'est un geste surprenant pour les novices qui ne saisissent
pas forcément comment ils vont pouvoir boire le thé de cette manière ! En
réalité, on pose la tasse de dégustation sur la tasse à parfums puis on
retourne l’ensemble pour inverser la position des tasses. Cette étape est appelée
« renverser le soleil (la tasse de dégustation) et la lune (tasse à
parfums) ». On soulève ensuite délicatement la tasse à parfums qui déverse
alors son contenu dans la tasse de dégustation. Cette méthode permet
d’imprégner de thé la tasse à parfums tout en remplissant parfaitement la tasse
de dégustation, qui est alors prête à être consommée. Les tasses sont le plus
souvent remplies aux deux tiers et jamais jusqu’au bord.
On commence par
sentir la tasse longue, désormais vide, pour apprécier les parfums du thé qui
se sont déposés sur ses parois, pendant que le thé refroidit légèrement dans
l’autre tasse. On boit ensuite son thé en plusieurs gorgées, « au moins
trois » si possible, en référence au caractère chinois 品 (pin), qui signifie
« déguster ». Cet idéogramme, formé de trois caractères de la bouche,
rappelle que la dégustation passe par de petites gorgées et non par
l’ingurgitation grossière d’une grande quantité de thé à la fois.
Pour déguster la
tasse de thé, on a vu que l’on distingue deux manières de tenir sa tasse :
celle des hommes et celle des femmes. La manière de boire est la même : on
aspire le thé à petite gorgées, parfois en le faisant rouler dans la bouche
pour éviter de se brûler.
« Pourquoi
tout les ustensiles de la cérémonie du thé sont-ils si petit ? »
s’entêtent à demander les novices de la préparation gongfu en découvrant les ustensiles. « Vous jouez à la
dinette », disent les mauvaises langues. Il s’agit en réalité, encore une
fois, de réunir tous les paramètres permettant d’infuser la tasse idéale. La
taille réduite des accessoires permet à celui qui infuse le thé d’avoir une
grande maîtrise à la fois de ses gestes, mais également des quantités et de la
température. Servez votre thé dans un grand bol et vous goûterez plus les joies
de vous brûler la langue et de terminer sur un mélange tiédasse plutôt que le
plaisir de déguster une excellente infusion. L'idéal est de boire le thé
chaud : si l’on choisit de se passer de la cruche et de verser directement
le thé dans les tasses, la taille de la théière sera optimisée pour qu'une
infusion permette de remplir les tasses de tous les participants. De cette
manière, les personnes présentes pourront goûter à un thé identique (ou
presque) et faire part de leurs impressions sur cette dégustation.
Aujourd'hui, on
peut accomplir ces gestes chez soi, avec son propre matériel, ou se rendre dans
une maison de thé ou des professionnels vous proposeront soit de faire du thé
pour vous, soit de vous apporter les ustensiles nécessaires et de vous laisser
faire.
[1] Kakuzô OKAKURA - Le livre du thé – Picquier Poche, 2006. - p. 39
.
Moins de deux mois avant la soutenance de mon mémoire sur les gongfu cha : une bonne occasion de tenir mes promesses en vous parlant enfin de thé. Et surtout, une bonne occasion pour moi de profiter de votre relecture critique. C'est le moment de vous exprimer dans les commentaires (ou par mail pour les timides) : orthographe, clarté, concision, etc., toutes les remarques sont les bienvenues.
Seul inconvénient pour vous : je n'écris pas dans l'ordre et je ne publie donc pas non plus les articles dans un ordre logique. Ca se trouve, vous découvrirez la définition du gongfu cha tout à la fin. Pauvres lecteurs.
On commence avec une petite typologie des thés chinois pour bien comprendre de quoi il s'agit.
Les feuilles de thé
Le thé : ne
nous méprenons pas sur ce que recouvre ici ce terme. Il ne s’agit pas ici de cette
infusion brune arrachée à un sachet et auquel il faut ajouter lait, sucre, ou
citron pour donner du goût, ni du liquide fort tiré d’un samovar ou du bol
d’eau bouillante sur lequel flottent quelques fleurs de chrysanthèmes comme on
en sert dans les restaurants chinois. Pour comprendre la cérémonie du thé, il
semble indispensable d’avoir une connaissance précise de l’objet traité dans
cette cérémonie. Si les thés chinois recouvrent des centaines de variétés de
thés de bonne qualité cultivés en Chine, on peut les regrouper en quelques
catégories permettant de mieux comprendre de quel objet il s’agit. En effet, le
gongfu cha est une technique de
préparation du thé élaborée pour les thés provenant de Chine et s’applique donc,
en général, à un nombre restreint de types de thés. Cependant, le gongfu cha n’est pas jaloux et accepte
volontiers de partager ses secrets : son objectif étant de magnifier le
goût du thé, n’importe quel thé peut être préparé à la façon gongfu. Mon Daarjeling first flush
exceptionnel n’est jamais aussi bon que quand il est préparé dans ma théière
Yixing.
Cela n’empêche que le gongfu cha tel qu’il est pratiqué au quotidien en Chine ne concerne que des thés cultivés dans quelques provinces du sud et de l’est de la Chine.
![]()
Avant de distinguer
les processus de fabrication des thés à partir des feuilles fraiches, rappelons
que, contrairement à ce que l’on entend fréquemment, la feuille de thé ne
provient pas simplement du Camelia sinensis dont il existe des dizaines de
variétés qui sont autant de cépages apportant au produit fini une palette de
saveurs extraordinaire. Les crus, les sols et les climats sont des éléments déterminants.
Revenons sur ces
catégories, essentielles à la compréhension de la cérémonie.
La feuille de
théier, une fois cueillie, subit certaines transformations. Celles-ci ont pour
but initial de rendre le thé plus facile à conserver et à transporter. Les
différentes techniques utilisées ont donné naissance aux différents types de
thés.
En Chine, les
étapes classiques de fabrication du thé sont les suivantes :
Le flétrissage : le thé est chauffé pendant
plusieurs heures, ramollissant ses feuilles et lui permettant de perdre une
partie de son eau.
La fermentation : le thé est ensuite fermenté, c'est
à dire exposé à des conditions de chaleur et d’humidité favorisant l’oxydation
enzymatique des feuilles. De la fermentation dépend largement la qualité du
thé : trop fermentées, les feuilles sembleront brûlées, peu fermentées,
elles risqueront d’être amères. Pour certains thés, comme le Pu’Er cuit, cette
fermentation a lieu dans une pièce spéciale garantissant un environnement
extrêmement humide (de 90 à 95%) et une température constante et élevée (autour
de 22°).
La torréfaction : les feuilles de thé sont passées à
la vapeur
Le roulage : les feuilles sont ensuite roulées,
ce qui permet de casser les cellules et de libérer les huiles essentielles
contenues dans les fibres.
La dessiccation : cette phase consiste à stopper la
fermentation des feuilles. C'est une étape délicate dans laquelle les feuilles
doivent être soumises à une ambiance sèche et à une température élevée pour ne
conserver qu’une très faible part de leur humidité (2 à 3%).
Le criblage : également appelée tamisage,
cette opération consiste à trier les feuilles selon leur grade et leur taille
pour en distinguer les différentes qualités.
Les feuilles sont
ensuite conditionnées.
Tous les thés ne subissent pas toutes ces étapes. On
classe les thés selon plusieurs critères. Le premier est la fermentation. On
distingue alors les thés non fermentés (绿茶thés verts), les thés partiellement
fermentés (乌龙Wulong)
et les thés totalement fermentés (红茶,黑茶thés rouges et noirs).
Ces trois
catégories peuvent à nouveau se subdiviser lorsque l’on ajoute le critère de
l’oxydation. On compte alors six catégories de thés :
- le
thé blanc : 白茶
Ce thé est souvent
intégré dans la même catégorie que le thé vert dans la mesure où il ne subit
pas de fermentation, mais son processus de séchage est différent. C'est le thé
qui subit le moins de transformation entre sa cueillette et sa consommation et
qui conserve le plus les propriétés des feuilles fraiches. Les jeunes feuilles
sont cueillies avec les bourgeons, séchées au soleil, puis à l’ombre, et
parfois torréfiées.
Quelques thés
blancs :
白毫银针Bai hao yin zhen
白牡丹Bai mudan
- le
thé vert : 绿茶
Les feuilles sont
flétries après la cueillette puis séchées dans des bassines de cuivre
(dessiccation) pour empêcher leur fermentation en détruisant les enzymes. Elles
sont ensuite roulées ou pressées.
Quelques thés verts :
龙井Long
jing
碧螺春Bi
luo qun
安吉白茶An ji bai cha
信阳毛尖Xin miang mao jian
黄山毛峰Huang shan mao feng
太平猴魁Tai ping you kui
- le
thé jaune : 黄茶
Le processus de
préparation des feuilles de thé jaune est semblable à celui du thé vert, à cela
près que les feuilles subissent une phase de fermentation post-enzymatique. Les
feuilles de thé destinées au thé jaune sont flétries, torréfiées et roulées
puis recouvertes d’un linge humide et rassemblée par petits tas dans des
conditions d’humidité extrême (80 à 90%) pendant une vingtaine d’heures. Après
leur oxydation, le processus se termine par une dessiccation.
Quelques thés
jaunes :
君山银针 Jun shan yin zhen
蒙顶黄芽 Meng ding huang ya
- les thés Wulong 乌龙茶
Le thé wulong est
un thé partiellement fermenté. Cependant, le pourcentage de fermentation varie
d’environ 12 à 70% faisant de ces thés « bleu-vert » une catégorie
vaste présentant des types de feuilles extrêmement différents. Après
flétrissage, le wulong est brassé dans de grands paniers et fermenté. Le
brassage permet d’abîmer les bords et d’augmenter la surface d’oxydation. Cette
fermentation est arrêtée par chauffage dans une grande bassine de cuivre.
Certains thés sont torréfiés, tous sont ensuite roulés, puis séchés.
Trois provinces sont principalement productrices de Wulong : le Fujian, Taiwan et le Guangdong. Ces trois provinces sont également les provinces où l’on pratique le plus le gongfu cha.
![]()
Quelques thés
Wulong :
铁观音jie
guan yin
大红袍
da hong pao
风凰单枞 feng huang dan cong
冻顶 dongding
- le thé rouge 红茶
C'est un thé qui a
subi une fermentation enzymatique. Après le flétrissage et le roulage, les
feuilles sont entreposées dans une pièce chaude et humide favorisant la
fermentation. Celle-ci est stoppée par le procédé de dessiccation. On rappelle
souvent que ce que les Chinois dénomment thé rouge et thé noir sont
généralement, en Occident, réunis dans une seule et même catégorie, celle des
thés noirs. C'est parmi les thés rouge que l’on trouve les thés fumés.
Quelques thés
rouges :
正山小种zheng shan xiao zhong (Lapsang Souchong)
祁門 qi men (Keemun)
- le thé noir 黑茶
Le thé noir, dont on connait principalement les Pu’Er, est un thé post fermenté. Le thé subit généralement une première fermentation avant d’être exposé à une atmosphère propice à l’oxydation des feuilles, créant une nouvelle phase de fermentation. Les thés noirs sont généralement produits dans le Yunnan, le Hubei et le Sichuan. Le processus de post fermentation étant été développé dans un but de conservation, ce sont souvent les thés noirs qui sont consommés dans les provinces ou pays éloignés des zones de production. C'est également pour cette raison que l’on peut trouver le thé noir sous forme de briques compressées qui facilitaient le transport à dos d’animaux.
En ce qui concerne
le Pu’Er, on en distingue deux sortes dont la post fermentation : le Pu’Er
cru et le Pu’Er cuit.
Pu’Er cru (生普洱) :
Après la
cueillette, les feuilles de thé sont flétries puis chauffées de manière à
neutraliser les enzymes responsables de leur oxydation. Les feuilles sont
ensuite séchées au soleil ou, si les conditions météorologiques ne le
permettent pas, séchés à faible température. Les feuilles sont séchées jusqu’à
enlever environ 90% de leur humidité. Elles sont ensuite triées et séparées
selon leur qualité, et mélangées en fonction de recettes propres à chaque
Maison. Les feuilles sont enfin passées à la a vapeur pour leur permettre
d’être compressées en briques sans se casser. Les galettes de thé compressées
sont ensuite stockées dans une atmosphère sèche pour leur permettre de
commencer leur processus de vieillissement. Ce stockage, qui nécessite beaucoup
de temps et de patience avant la consommation, fait la valeur de ce thé
mais a également conduit à développer de
nouvelles méthodes de post-fermentation qui accélèrent le processus.
Pu’Er cuit (熟普洱)
:
Le Pu’er cuit subit une fermentation accélérée après le flétrissage et le chauffage. Cette technique, développée dans les années 1970 permet en effet d’obtenir une post fermentation en temps record. Pour cela, le thé est placé en tas dans une salle très humide à température très élevée selon un principe rappelant celui de la fabrication du compost. Pour que les bactéries nécessaires à l’oxydation se développent, on arrose d’eau les tas de thé qui sont ensuite recouverts de bâches. Le thé sera régulièrement mélangé pendant les plusieurs semaines que durera la fermentation, puis il sera séché et conditionné.
La qualité
Stéphane Erler
détaille cinq critères qui sur lesquels se baser pour définir un bon thé :
- la
qualité des feuilles : leur couleur brillante et forte, leur densité sera
un gage de qualité. Le plus souvent, on étudie également les feuilles ouvertes,
après leur infusion, pour voir leurs caractéristiques, leur taille, etc.
- l’odeur : un
thé de bonne qualité dégagera une odeur pure et fraiche ou un mélange de
senteur complexe et raffiné. Le thé croit en valeur lorsque ses feuilles se
chargent d’odeurs de fleurs, de fruits et d’épices nobles et rares. Un thé qui
rappellera l’odeur acre de l’engrais utilisé pour le faire pousser (le soja par
exemple) aura peu de valeur alors que certains thés aux odeurs harmonieuses
comme le Wulong 肉桂 (Rou gui) de Wuyishan[1],
rappelant la cannelle ou les fleurs de narcisses, auront une grande valeur et
une saveur de qualité. Les thés Pu’Er, dont l’odeur est extrêmement
particulière, se chargent le plus souvent de parfums rappelant la nature :
champs après la pluie, terre, bois mouillé, etc. Plus les odeurs qui se
dégagent des feuilles rappelleront un matériau noble et s’éloigneront des
odeurs de fumier et d’animaux de la ferme, plus le thé pourra être considéré
comme étant de bonne qualité !
- la
persistance : la qualité d’un thé se reconnait également à la durée du
plaisir que ses arômes apporteront au palais. Comme pour le vin, la persistance
aromatique dépendra de la teneur en tanins du thé et de l’équilibre entre
l’acidité et le moelleux.
- La
concentration de l’infusion : certains thés très concentrés permettent de
tirer un très grand nombre d’infusions d’une quantité de feuilles donnée, alors
que d’autres thés ne pourront être tirés que quelques fois. Pour des raisons de
rendement évidentes, on préférera les thés les plus concentrés.
- La
pureté et l’harmonie : on loue généralement les grands thés pour la
complexité de leurs arômes mais la multitude de goûts différents dans un thé ne
doit pas aller sans un critère d’harmonie. Un bon thé a des odeurs et des goûts
pur et cohérents qui s’assortissent et donnent à l’ensemble un accord délicat.
[1] 武夷山
Depuis mes déboires chez le docteur Sun, je suis revenue à la médecine occidentale, qui coûte plus cher mais fait moins mal. Aujourd'hui, pour dépenser une grande partie de mon salaire mensuel, je suis allée faire faire un IRM. Comme la clinique internationale ne dispose pas d'installations à cet effet, elle prend les rendez-vous pour les patients dans des hôpitaux publics pékinois.
Je pars donc à l'autre bout de Pékin, accompagnée par une infirmière, direction l'hôpital n°403. J'avais déjà remarqué cette tendance à numéroter les établissements scolaires, je découvre que la même mode existe pour les hôpitaux.
Mes premiers pas dans le hall de l'hôpital me rappellent une gare du centre de New Delhi ou un foyer d'accueil pour SDF aux heures de pointes. Des gens trainent, fument, attendent assis par terre. Des malades sur des brancards attendent, la plupart inconscients. Un hôtesse en blouse blanche rebrodée de manches ballons roses donne des renseignements.
On me fait patienter dans un couloir près des ascenseurs. Des ouvriers viennent d'arriver pour réparer l'un des deux, créant un embouteillage de fauteuils roulants et de brancards. Jamais vu autant de brancards de ma vie, même à l'hôpital. Il n'y a pas d'infirmiers pour pousser les brancards, la famille entoure le lit et se charge de déplacer le patient. En revanche, les infirmiers sont venus aider les ouvriers à réparer l'ascenseur malade. Après avoir réparé l'appareil, ils laisseront des plastiques d'emballage et des mouchoirs sales par terre au milieu du couloir de l'hôpital. Un petit balayeur passera 20 minutes plus tard enlever tout ça.
On ne trouve pas ici comme en France des cabinets médicaux pour les médecins généralistes ou de Centres d'imagerie médicale qui recoivent sur rendez-vous. Le rhume, la peste, l'urticaire ou la brûlure à l'huile bouillante : c'est l'hôpital. Du coup, on retrouve dans la salle d'attente de l'IRM tout et n'importe quoi : des vieux qui viennent de tomber, des vieux qui sont tombés il y a longtemps, un petit garçon de 10 ans qui a visiblement cogné très fort sa tête et a perdu connaissance, un petit garçon trisomique, une étrangère qui a mal au dos, et d'autres qui ne portent pas sur leur visage le nom de leur maladie. J'accepte de laisser passer devant moi le petit garçon évanoui. Sa mère le tient allongé sur ses genoux depuis un bon moment. Lorsque vient son tour, ses parents le portent péniblement en piétinant jusqu'à la salle d'examen. Avec tous les brancards qui circulent dans ces couloirs, on aurait pu lui en donner un.
Le petit garçon trisomique est très turbulent. Mais on ne l'entend pas tellement, parce que ses cris sont couverts par les sonneries de portables, les appels au micro pour "le scanner suivant", les piallements des familles autour des malades. Ah ! La famille ! Personne ici visiblement ne vient seul faire des examens. Un jeune gendarme est venu avec 6 collègues. Un vieux en corset avec sa femme, deux de ses enfants, son gendre et sa belle fille. Le petit garçon sonné avec ses deux parents, pareil pour le petit trisomique. Une dame avec sa fille et son mari. Moi avec une infirmière. Un médecin désabusé passe en trainant les pieds chaussés de tongs de piscine. Le petit garçon trisomique a entrepris de lécher une porte. Après une heure d'attente pour l'impression des images, je quitte enfin le bruit et la poussière. Le petit garçon est troujours inconscient, allongé en travers de deux chaises de salle d'attente.
L'avantage d'avoir fait trainer la publication de ce post est que vous êtes maintenant dans le même état que moi à ce stade du mariage : vous avez faim (à moins que vous ayez complètement décroché et supprimé ce blog mort de vos favoris). Je précise, pour ma défense, que j'ai dû télécharger un logiciel proxy pédophile pour pouvoir enfin poster des articles : depuis que nous avons célébré en silence les 30 ans de silence depuis juin 1989, le web a été réduit au silence et canalblog a rejoint avec blogspot et gmail les sites muets qui ne s'affichent plus.
Passons à table.
A table ? Pas encore !
L'arrivée au restaurant se fait en grandes pompes, les dragons humains sautillants se sont téléportés sur le parking pendant que l'on faisait des photos dans les prés, les pétards sont au rendez-vous, une foule d'inconnus nous attend. 400 invités au total, dont les mariés m'avouent ne connaitre "que 30% environ". Ce sont des voisins, amis d'amis, cousins de grandes tantes et piques assiettes en tous genres. Le restaurant se trouve dans l'hôtel dans lequel nous avons dormi. J'aurais pu me lever à 11h et être à l'heure à la cérémonie.
L'entrée de la mariée est censée avoir lieu à 11h38 pétantes. Il fallait un "8" pour faire du bonheur. La mariée se repomponne dans une chambre prêtée par l'hôtel, les maquilleuses de l'aube ont suivi et font quelques retouches. Les invités, eux, émargent dans un livre d'or avec des stylos surmontés de cœurs roses en plumes.
Comme la mariée est un peu à la bourre, on décide de reporter à 12h08 le début. Elle engouffre un bout de poulet pour tenir le coup, j'ai droit à un demi-ravioli avant d'aller me mettre en place pour le début. Le stress commence à monter : déjà que je ne tiens pas à l'alcool quand j'ai l'estomac plein, alors si je dois trinquer avec chaque table en état d'hypoglycémie avancé, ça va pas être beau.
La salle est organisée avec une scène sur laquelle sont placés les chaises pour la famille des mariés, une table pour les flûtes à champagne, un stock de bougies romantiques et de petits promontoires pour les fleurs. Dans le fond, sur le voilage rose, on peut lire les noms des mariés à coté d'une photo d'eux et en lettre roses : "mariage romantique".
La scène et les bougies
La pyramide de flûtes à champagne
Les chaises des parents
J'ai été bien inspirée en choisissant une robe rose. J'avais déjà l'air d'un petit cochon, mais avec un décor pareil, je vais avoir l'air tout droit sortie d'un Walt Disney.
En face de la scène, on trouve 40 tables pour les invités garnies de fleurs, d'amuses-bouche, de bonbons et bien sûr, d'alcool. Plusieurs bouteilles d'alcool blanc de marques différentes et du vin à étiquette romantique qui se révèlera à peine buvable. Les plats qui suivront se révèleront également assez décevants d'après mon observateur personnel placé dans la salle. On peut apercevoir sur la photo les baguettes jetables en bois dans leur sachet plastique.
La table
Le vin qu'on aurait préféré moins romantique mais meilleur au palais
Et puis, enfin, ça commence. Les témoins se placent dans l'allée, sur le passage de la mariée. Les gens murmurent que si la mariée a une témoin étrangère, c'est qu'elle-même ne doit sûrement pas être Chinoise. Certains disent Russe, d'autre Américaine. Je trouve effarant d'aller à un mariage en n'ayant aucune idée de qui épouse qui.
Nono fait son entrée au bras de son père, sur une musique de mariage. Arrivée à notre niveau, le marié, qui est venu à sa rencontre, s'agenouille devant elle avec le bouquet et la demande en mariage. Le papa lui donne la main de sa fille et ils partent tous les deux vers la scène. J'échange un regard entendu avec mon amoureux assis au premier rang : un truc aussi niais, chez nous, c'est un motif de divorce. On est d'accord.
Tam tam tadam, tam tam tadam...
Cette petite mise en scène est un peu passée inaperçue puisque les invités ont commencé à attaquer les plats qui arrivaient à table. Entre manger et suivre le cours des événements, ils ont choisi, et la cérémonie commence dans un grand fracas de baguettes et de tintements de verres. Les invités parlent entre eux, décortiquent des poissons, engouffrent des cacahuètes et sont à des années lumières de s'intéresser à ce qui se passe sur scène. On peut le comprendre d'ailleurs, après tout, pour la plupart, ils ne savent pas qui sont les deux gugusses qui s'épousent.
Sur scène, on réunit les mariés, les témoins, les parents, le caméraman agaçant et une présentatrice mièvre, neu-neu et mielleuse en veste rose qui ne cessera de parler en soupirant langoureusement que pour laisser les mariés répondre à ses questions bêtes. J'en connais un qui l'aurait volontiers poussée de la scène. Sa seule qualité est d'avoir fait un effort vestimentaire, ce qui n'est vraiment pas le cas de tout le monde. J'ai l'air d'une star hollywoodienne échouée dans le Larzac.
On stage
La cérémonie comprend ensuite (dans le désordre) : des remerciements des mariés (merci le Shandong, merci Pékin, merci les parents, merci les invités, merci les témoins, bla bla bla), des discours des parents, des interventions intempestives de la présentatrice pour dire des trucs cucus en soupirant, la lecture par le marié de la première lettre d'amour qu'il avait écrite à la mariée, un discours d'un tonton qui sort de je-ne-sais-où, la lecture par un pseudo-représentant officiel de l'acte de mariage, le recueillement ému des mariés devant des bougies en forme de cœur allumées par leurs soins, les discours des témoins, les pleurs de la maman, une émouvante offrande du bouquet de fleurs de la mariée à sa cousine, des échanges de vin rouge entre époux, puis entre les époux et les témoins, des cadeaux de thé aux parents, un cul-sec de champagne rose général, des prosternations par grappes de 3 devant les parents, les invités, les mariés entre eux, et pleins d'autres choses que je n'ai pas comprises.
Le champagne rose, c'est plus romantique
Ne cherchez pas la signification, il n'y en a pas
J'aurais préféré manger que boire
Si t'as mal au dos, tu peux pas te marier
Brochette de cousines émues et larmoyantes
Le stress m'a empêchée de réciter par cœur le discours que, la veille, j'avais pourtant bachoté jusqu'à une heure avancée de la nuit. Au moment de parler, la présentatrice a annoncé mon intervention, non pas en disant qu'en tant que témoin, j'avais été obligée de préparer un truc (la vérité), mais en déclarant que la mariée, qui était prof de chinois, avait une élève qui avait très envie de dire quelques mots au public dans la langue qu'elle apprenait. Grosse vache, va.
On a ensuite marqué une pause, permettant à la mariée de changer de robe, à la présentatrice de reposer sa voix et aux témoins de faire pipi. La deuxième partie de la cérémonie a principalement consisté en des chansons interprétées par les mariés et leurs proches sur un accompagnement karaoké.
Chansonnette
L'exercice suivant devait nous amener à faire le tour de toutes les tables pour trinquer. On a commencé par les tables disposées dans deux salles à part, relativement éloignées de la salle dans laquelle se déroulait la cérémonie, et dans laquelle se trouvaient les collègues de travail des papas des mariés. J'ai trouvé assez bizarre de venir de Pékin jusque dans le Shandong pour assister à un mariage en restant dans une salle à part entre collègues sans être présent au moment de la cérémonie. En plus du fait que je trouve bizarre d'inviter les collègues de son père à son mariage, mais c'est secondaire à ce stade. (Papa, tu es prévenu).
On me colle dans les mains des bouteilles de vin rouge, et l'autre témoin hérite de bouteilles d'alcool blanc. Au moment de servir les invités pour que la mariée trinque avec eux, le caméraman stupide propose l'idée de verser à deux dans le même verre les alcools différents.
Résultat, on verse en cœur dans des verres du vin rouge dégueu et de la baijiu que les invités ingurgitent en cul sec après avoir bruyamment trinqué. La mariée et sa maman (les parents suivent et boivent aussi) trempent délicatement leurs lèvres dans le verre à chaque round. On sent la prudence. Quand on me propose de boire, je lève les bras en signe d'impuissance montrant que je meurs d'envie de goûter à un mélange baijiu-vinaigre mais que j'ai les mains prises.
Après avoir fait le tour des deux pièces isolées, nous retournons dans la salle principale. La plupart des invités sont déjà partis, les serveurs sont en train de ramasser la vaisselle sale. Seuls les proches amis et la famille (3 tables sur 40) sont encore là. Bizarre de filer en douce à un mariage à 13h30 pendant que la mariée est dans la pièce à coté et après s'être empiffré sans rien écouter. La mariée boit encore deux-trois verres avec les tables restantes.
C'est à ce moment là seulement, vers 14h00, que j'ai pu aller m'asseoir à une table et finir gloutonnement les restes comme si on ne m'avait pas nourrie depuis une semaine (ce qui était presque le cas, avouez-le). Et enlever sous la table les chaussures à talons que je portais depuis 6h du matin.
Rappelez-vous (je sais, c'est loin) : quand la mariée protestait pour dire qu'elle voulait organiser son mariage comme elle l'entendait, on lui répondait pouet-pouet, c'est pas pour toi que tu te maries mais pour mettre en scène ton union, alors camembert (en Chinois on ne lui dit pas exactement "camembert" mais je m'adapte au lecteur français).
On a bien vu qu'avant même tout mariage, on commence par les photos. Eh bien figurez-vous que pendant le mariage, ça continue. Et après le mariage, on les affiche. Et encore après, on les regarde. Ou on les envoie. Ou on les dépoussière. En tout cas, pas de mariés sans caméras ni flashes. C'est l'objet d'une partie entière du mariage. Il est 10h : c'est maintenant.
Je remonte dans ma petite voiture
Première étape : le champs de poiriers. Dans l'imaginaire de la mariée, le champs cumule deux avantages : celui d'être méga romantique à cette saison de l'année (fleurettes blanches) et celui d'être typique du Shandong et donc de faire couleur locale. Mais si, vous savez bien, les poires du Shandong. Dans la réalité du terrain, le champs de poiriers cumule deux défauts : celui d'être en extérieur (et il fait froid), et celui de n'être pas praticable en talons aiguilles. Mais on dira que je m'attache trop aux détails.
Cherchez la poire
La procession s'envole donc vers un champs de poiriers célèbre, notamment à cette époque de l'année. Précisément ce jour-là, c'est la fête de la poire dans le Shandong. Le mois d'avril a ceci de magique en Chine que pour célébrer la fête de la poire, on choisi le mois ou les poiriers sont en fleurs. Et on vend des poires par cartons entiers : cherchez l'erreur.
Pas de poires à manger pour nous, tais-toi et nage, MaRong. Et souris aussi, au photographe. En gros, l'exercice consiste à se prendre en photo dans les champs. Un peu décevant comme décor, surtout du fait que le sol est en terre battue, le ciel laiteux et parsemé de pilônes électriques.
Smile
La mariée pose avec chaque poire et chaque trombine, même de parfaits inconnus qui se baladaient justement eux aussi en troupeaux dans des champs de poiriers.
T'es qui, toi ?
Les gens s'attroupent, regardent, commentent. Et les flashes pleuvent.
Clic again !
Tout ça nous prend une bonne demi-heure, durée relativement longue quand on la passe à marcher en talons hauts dans du sable avec l'estomac vide.
On remonte en auto, une autre cette fois, car la limousine est tellement incomfortable et incapable de rouler sur le terrain impraticable des champs que la BMW noire qui arrivait en #2 dans la hierarchie reçoit subitement les faveurs de la mariée. C'est une bonne occasion aussi de virer le photographe/caméraman insupportable qui occupait la voiture avec nous.
La deuxième étape est quasimment la même, sauf qu'elle n'est pas au milieu des arbres fruitiers mais au bord d'une rivière. Le jeu est le même : photo à coté d'un arbre, photo à coté d'un poteau, photo dans l'herbe, photo à 2, photo tout seul. Et le pire : photo à la queue leu leu
Chercher le sens...
L'essentiel quand même, c'est que ça a plu aux mariés.
.
C'est ensuite le tour d'une sorte de vin d'honneur, petite sauterie intime dans la maison des parents de l'époux. La dernière fois que j'ai été invitée à un vin d'honneur, j'ai mangé de délicieux petits fours avec un bon rosé de Provence. Les Chinois ont une vision légèrement différente de la chose. Peut-être parce qu'il est 9h15 et que les gens normaux ont déjeuné et n'ont pas encore faim pour le repas de midi. Bande de chanceux.
Pour la mariée, c'est un peu différent : elle n'a pas vraiment faim, mais la succession de misères qu'on va lui faire va lui remplir le ventre.
On dépose les mariés pailletés sur leur lit, fortement décoré pour l'occasion : les taies d'oreillers ont été recouvertes de serviettes rose fluo représentant le double bonheur, une photo d'eux est accrochée au-dessus du lit. Les badauds dont je fais partie se tassent dans la chambre, les flashes crépitent et les caméras tournent.
Attend, moi aussi je veux voir
Ugly beddy
Le marié a pris soin d'enlever les chaussures de Nono, ce qui tient plus du mal aux pieds que de la tradition.
Pendant que la mariée s'époussète, les dragons rangent leurs instruments bling-bling.
Début de l'épreuve du lit
Finie la fête
Ça n'amuse que les étrangers et les enfants
Le dragon sans tête
La tête sans dragon
Dans la rue, la limousine n'a pas encore osé tenter la marche arrière.
Peureuse
C'est ce moment qui est choisi pour l'entrée des raviolis et des nouilles.
Dans la tradition chinoise, le mariage doit être suivi le plus rapidement possible d'un bébé. Dans les vœux faits aux mariés, le 早生贵子 qui leur souhaite un beau bébé très vite, est l'un des souhaits les plus formulés. Si ça se fait dans la semaine, c'est mieux. Pour les mariées un peu idiotes et les mariés un peu empotés, tout un tas de formules et de jeux suggestifs orchestrés par la famille font des appels du pied.
On commence par le ravioli pour mettre les époux en appétit. Une tante au regard lubrique fourre dans la bouche des deux jeunes innocents des raviolis au porc qu'ils doivent partager lors de langoureux baisers.
Une cuillère pour Monsieur
Une cuillère pour Madame
Contrairement à d'autres, la jolie mariée n'a pas faim et développe des techniques secrètes pour gaver son amoureux.
Cadeau
Le tout dans une manque d'intimité flagrant.
Ça amuse beaucoup la foule, en tous cas.
Gniarf Gniarf
Vient ensuite le tour de la nouille. La nouille, bien plus fourbe que le ravioli, est cuite quelques minutes seulement pour garder un coté croquant évident. Quand on la fourre dans la bouche de la jeune femme qui doit mâcher un truc super dur, on en profite pour lui poser la question : 熟吗 ? ("est-ce que c'est cuit ?"), et comme de toute évidence ce n'est pas cuit, celle-ci doit répondre 生 ! ("c'est cru !") sachant que cela signifie également "naître".
En gros on profite de piéger une jeune vierge avec de la bouffe dégueulasse pour lui faire promettre en public qu'elle va mettre un rejeton en route dans la soirée.
Nouille crue prémâchée par amoureux dépassé par les événements
Si t'en r'veux, y en r'n'a
Évidemment, les mariées d'aujourd'hui on vu le monde bien avant que leur parents s'en doutent et jouent un peu avec la tradition. Nono, en l'occurrence, a répondu à la question fatidique par un "c'est pas cuit et c'est pas bon" qui a heureusement été pris avec le sourire.
Vient ensuite un échange romantique de verres de vin à l'aide de verres reliés par un fil rouge.
干杯
Une dégustation de bonbons (symbole de l'enfant) reliés par des baguettes rouges.
...
Suivi par un croquage de pomme langoureux et acrobatique.
Le dessert
Il faudra aussi aller récupérer avec la bouche une baguette égarée dans une bouteille de bière.
Je m'éclipse pour aller manger un ravioli en cuisine le temps que les mariés descendent pour une longue série de photos de famille dans la cour de la maison.
Ce sera l'occasion d'admirer à quel point "se mettre sur son 31" est optionnel pour un mariage chinois, même pour la famille proche. Heureusement que je suis témoin, j'aurais pu être overdressed.
Happy family
.
L'épisode qui suit est celui où le marié ramène sa belle à son domicile. Une procession d'invités se rendent à leurs voitures, en marchant par ordre d'importance les uns derrières les autres. A chaque étape, photo.
Étape photo
Les témoins ont eu l'exceptionnelle autorisation de monter en voiture avec les mariés. En théorie, ils doivent arriver en deuxième place dans la voiture qui suit les époux. En l'occurrence, l'auto qui nous emmène vers le temple de l'amour conjugal est une limousine d'un très vieux modèle, élimée aux coins et râpée sur les sièges. On se serre quand même tous au fond pour avoir l'air d'être dans une Mini Cooper. Symbole de l'amour éternel, le drapeau chinois flotte à chaque rétroviseur. Même Hu Jintao n'a pas un cortège diplomatique comme ça.
Coucou le drapeau
Les voitures, à la file, roulent au pas, au pas d'une tortue octogénaire fatiguée, en arborant leurs froufrous rouges devant les passants curieux. Curieux mais pas nombreux. Quelques paysans lève-tôt qui s'ennuient sur le pas de leur porte.
Les routes de Laiyang ressemblant moins à la Croisette qu'à la rive droite de la Meuse en 1917, la limousine doit s'arrêter régulièrement pour encaisser les nids de poules et éviter les gravas. Je m'étais moquée quelques jours plus tôt d'un cortège de mariage qui avait mis les époux dans un Hummer, mais cela semblait plus judicieux finalement.
A la grande surprise de la mariée qui n'avait rien commandé de pareil, un couple de dragons accompagné de musiciens traditionnels, nous escortent. Pour moi, c'est la meilleure partie du mariage. Franchement, des tambourins et des cymbales traditionnelles à fond dans la rue et des confettis partout, ça en jette. Si on ajoute à ça les pétards et les explosions de paillettes qui accueillent notre arrivée, c'est vraiment impressionnant. Même si, à regarder la tête des invités, le dragon qui sautille, ça n'amuse que moi. Une vraie touriste.
Limo & Dragons
L'histoire du dragon qui portait des Nike
L'arrivée devant la maison est un triomphe : paillettes, pétards, banderoles, tout saute en l'air en faisant du bruit. Une foule attend les mariés, prêt à asperger de serpentins gluants la coiffure qui a pris tant de temps à être réalisée.
Extirpation de la mariée en dehors de la voiture
Le marié porte sa belle dans ses bras, tel un un prince de contes à gros biscottos. On me fait attendre dans la limousine pour ne pas que l'on me voit sortir de la voiture des mariés : ça ne se fait pas.
Des trucs agaçants dans les cheveux
On me demande de me dépêcher de rejoindre la mariée qui a déjà passé la porte : qu'est-ce que j'ai à trainer comme ça ? La demoiselle d'honneur ne dois pas quitter sa belle d'une semelle.
Des inconnus et des piques-assiette
J'espère que le chauffeur réussira à faire une marche arrière avec sa limousine dans cette ruelle. J'ai vraiment faim. Il est 9h10.
.
Maquillée, coiffée, habillée. Il est 7h30, rendez-vous dans la chambre de la mariée.
Traditionnellement, le marié venait, accompagné de sa famille et de son témoin, chercher la jeune femme dans la maison de ses parents. Dans le cas, fréquent aujourd'hui, où les parents des époux viennent de deux régions éloignées, il faut s'arranger avec la tradition. Dans le Shandong, c'est donc la chambre d'hôtel qui symbolise la maison des parents de l'épouse.
De bon matin, les hommes quittent donc la maison du marié pour se rendre à l'hôtel. Pendant ce temps, la mariée prend place dans la chambre décorée, les filles de la maison et la demoiselle d'honneur l'entourant. Nous avons organisé un jeu de questions-réponses pour piéger le marié et nous avons caché la veille au soir, conformément à la tradition, une des chaussures de la mariée.
Cela m'angoisse beaucoup, qu'elle ne sache pas où sont ses chaussures. J'ai peur qu'on annule le mariage si elle ne les trouve pas, surtout qu'à mon goût, le soulier est vraiment bien caché.
Je questionne sur cette tradition la mère de Nono : est-ce qu'elle a aussi vécu cela lors de son mariage ? "Ouh là ! Non ! C'était bien différent !"
Vu le ton, ça avait l'air vachement moins fun.
.
La jolie mariée patiente
.
La chaussure esseulée
La mariée s'installe sur son lit recouvert de rouge, entourée de signes de double bonheur et de ses objets fétiches. Winnie l'ourson est là.
.
Wedding l'ourson
Devant la porte, c'est l'hystérie. les filles sont toutes excitées. Les garçons ont appelé pour prévenir qu'ils étaient en chemin. Ils seront là dans quelques minutes.
.
.
Gambettes impatientes
Quand le marié arrive, on ne le laisse tout d'abord pas entrer. Il doit répondre à toute une série de questions hurlées par les filles trépidantes. Saura-t-il prendre soin d'elle ? Peut-il dire sa date de naissance selon le calendrier traditionnel ? Qu'elle est sa chanson préférée ? Qu'aime-t-elle le plus manger ? S'il ne restait qu'un ravioli, l'offrirait-il à sa mère ou à sa femme ?
On lui fait jurer fidélité et amour, réciter un poème traditionnel en dialecte du Shandong. Par le battant de la porte légèrement entrebâillée, le marié fait passer des enveloppes rouges remplies de billets pour soudoyer les jeunes filles qui gardent la chambre. Il a rempli les enveloppes avec des billets donnés par ses parents avant de quitter la maison. Sa mère lui a, selon la tradition, présenté une assiette remplie de billets disposés tout autour. D'une main, il doit en attraper en une seule fois le plus possible. Je gagne 50 yuan.
.
Corruption
Il passe l'exercice avec succès et finit par entrer dans la chambre avec un bouquet de roses rouges.
.
Enfin
Pied de nez aux habitudes du Shandong, qui s'attendait à un chaste baiser sur le front, le marié embrasse sa chère et tendre en version française.
.
Shocking french kiss
La bizouillade terminée, retour à la tradition shandonguienne : l'accrochage de fleurs. Ce point a suscité un nombre de crispations indicibles lors de la préparation de la cérémonie. Il s'agit pour chaque proche de la mariée de porter une fleur sous laquelle pendouille une petite étiquette avec sa fonction : "père de la mariée", "témoin du marié", "invité d'honneur", etc. Cela devient un peu ridicule quand l'époux accroche sur la blanche robe de sa belle l'étiquette "nouvelle mariée", au risque de prendre les invités pour des truffes.
.
Le Port-Salut, c'est marqué dessus
Tout cela avec force mise en scène, photographies et autres filmationnages. L'opération se reproduit pour tous les participants importants au mariage.
.
Mon étiquette, ma fleur et moi
Puis vient l'épisode tant redouté (par moi seulement) de la recherche de chaussure. Le marié commence par enfiler la chaussure gauche, celle qu'on lui a laissée, à son épouse, avant de se mettre à fouiller la chambre.
.
Cherche âme sœur, désespérément
.
Pas dans le vase non plus
.
La voilà !
Après avoir démonté un conduit d'aération pour démasquer le fourbe escarpin , l'homme joue à Cendrillon avec sa belle.
.
Enfin deux pieds
S'ensuit une série de photos de familles avec la jolie épouse qui peut enfin marcher.
.
J'aurais bien aimé déjeuner, quand même
.
Clic !
.
Puis nous repartons vers d'autres aventures.
.
Il est 8h30.
.
.
.
.
Le mariage doit commencer à 11h38.
Pile.
Enfin, ça, c'est la théorie.
En réalité, être témoin au mariage, c'est faire sonner son réveil à 5h00 du matin pour être à l'heure au rendez-vous chez le coiffeur.
Oui. Il y a des coiffeurs qui ouvrent à 5h du matin, des coiffeurs dédiés aux mariées et qui s'adaptent à leurs horaires. Pas de photo de cette heure de gloire de ma paupière flanchissante, j'étais bien trop endormie quand j'ai tatonné dans le noir en cherchant mon pull pour avoir l'idée d'attrapper mon appareil photo.
A 5h20 quand nous arrivons, il y a déjà une jolie mariée qui est en train de se faire pomponner. Elle a une coiffeuse et une maquilleuse à ses côtés, qui s'agitent autour d'elle. Une couche de fond de teint impressionnante, de très grands yeux bien maquillés de noir, des boucles au fer à friser partout sur la tête.
La coiffeuse de Nono n'est pas encore arrivée. Elle débarquera complètement endormie, le cheveu froissé et la marque du drap sur la joue, avec 30 minutes de retard. Je ne suis visiblement pas la seule à avoir eu un réveil difficile.
)Les boucles mises en forme, la mariée qui se fait coiffer depuis une heure encore plus indécente que la notre est vraiment très jolie. Elle a un gros chignon d'anglaises avec une mèche lisse sur le devant.
Dans le salon, qui fait aussi office de studio photo, des accessoires de coiffure et des tenues de princesses s'entassent à coté des images encadrées d'autres futurs mariés. Un portant rempli de robes plus pailletées et froufrouteuses les unes que les autres, une armoire entière de fausses fleurs à mettre dans les cheveux, des bijoux fantaisies. Tout est toc et plastique. Les maquilleuses ensommeillées portent des vêtements enfilés à la hate, des traces de mascara de la veille, des pulls informes sur des tuniques fleuries, des talons vernis sur des chaussettes à motifs. Le sol du salon, que l'on a voulu festif, est recouvert d'une épaisse couche de confettis brillants qui font scrounch-scrounch quand on marche. Ca fait une impression de sale et de désordre qui donne envie de passer l'aspirateur et d'y voir plus clair.
La coiffeuse a posé dans les cheveux de la mariée d'en face un gros lys blanc sur le côté, c'est magnifique. Sur ses cheveux ébènes, c'est délicat est frais, une vraie bru comme on les rêve (si vous rêvez de brus).
Nono se fait toiletter aussi. Anti-cernes, fond de teint, poudre, illuminateur, recourbe-cils, mascara, fard à paupière, crayon, blush, tout y passe. Le fer à friser s'agite aussi sur sa tête, elle a des boucles partout.
La mariée d'en face a maintenant 6 roses dans les cheveux pour tenir companie au lys blanc. C'est dommage, il était bien, tout seul, et les roses roses plombent un peu l'ambiance.
Le temps passe, Nono est de plus en plus belle, moi de plus en plus fatiguée. Comme elle a réussi la veille, in extremis, à se décider sur la robe qu'elle porterait, elle sait enfin qu'elle aura un bustier. Le fond de teint descend donc jusqu'au milieu du dos et le long des bras pour éviter les démarcations.
La coiffeuse rajoute des brins de lavande avec les roses roses et le lys blanc. Je cherche une signification.
Nono m'avait proposé de me faire maquiller aussi, mais compte tenu du retard de la coiffeuse assoupie, il ne me reste presque plus de temps.
Pour aller avec le lys, les roses et la lavande, elle met de la gypsophile un peu partout autour. Peut-être que c'est une technique pour éviter de porter le bouquet de mariée dans les mains. Ca doit être lourd, quand même.
Nono est très belle. Le voile est accroché sous son amas de boucles rassémblées en cascade.
La mariée d'en face a aussi un voile accroché sous les roses roses, le lys blanc, la lavande et la gypsophile.
Plus de temps pour me maquiller et me coiffer : on organise sur ma tête un rapide chignon simple et une maquilleuse nonchalante attaque au recourbe-cils ma paupière qui ronflait avant de la taxer d'une petite couche de masacara noir.
Même pour aller acheter mon pain, je ne sors pas aussi peu apprêtée.
Mais c'est peut-être mieux ainsi : la jolie dame d'en face a maintenant une couche de paillettes argentées et une couche de paillettes dorées sur les cheveux, mêlées aux roses roses, au lys blanc, aux brins de lavande, à la gypsophile et au voile de mariée.
6h30. Il faut retourner à l'hotel nous habiller.
J'aurais bien aimé déjeuner, quand même.
Après une terrible nuit en companie de voisins bruyants et irrespectueux sur les couchettes dures d'un vieux train Pékin-Weihai, nous descendons à Laiyang où Nono nous attend. La maison du marié est déjà en pleine ébullition : on colle et on accroche des papiers découpés et des pandeloques, on a invité les voisins pour produire des raviolis en quantités industrielle pour le repas du soir. La suite en images.
Le double bonheur, placardé sur chaque fenêtre
Au dessus du lit, dans la chambre à coucher, une incitation à "早生贵子", avoir vite des enfants
Réalisé par une voisine, un ouvrage au point de croix encadré dans un couloir souhaitant longue vie et amour aux jeunes mariés
Encore du bonheur double ration...
Le poster : romantisme et amour éternel dans l'imaginaire chinois
Exercice d'escalade pour accrochage de lanterne
La lanterne en question
La fabrique de ravioli
Les mains dans la farine
La ronde des ravioli au porc
Ma technique (enfin, la technique pékinoise, mais dans le Shandong ça fait jaser)
Et dire que seuls les amis et parents du marié y auront droit !
La technique secrète que même quand tu la connais t'arrive pas à la faire
Mmmmmmm !
Des ravioli pour 80 personnes, qui dit mieux ?
.
.
Nono revient du Shandong, un mois avant le mariage. Un week-end de préparatifs, de réservations de restaurant et d’hôtel, de choix de fleurs et de coiffure. Elle a engagé deux entreprises d’organisation de mariage, une dans le Shandong, et une à Pékin. Avec l’entreprise pékinoise, elle a fait faire des robes, elle a choisi le restaurant, elle a donné des plans de table.
Le choix de la robe a été soumis à l’avis de sa mère qui refusait catégoriquement que le qipao qu’elle faisait tailler soit aussi échancré derrière. La négociation a abouti à un décolleté arrivant au milieu du dos.
Au final, elle a choisi 5 robes, sans savoir vraiment laquelle elle porterait à quel moment du mariage. La robe de mariée blanche sera pour la cérémonie dans le Shandong, la robe de bal bleue pour le mariage à Pékin. En ce qui concerne les trois autres qipao, elle verra plus tard comment elle les utilisera.
Dans le Shandong, les décisions sont plus difficiles à prendre. En plus de respecter la volonté de ses parents, elle doit respecter les traditions de la campagne et les traditions spécifiques au Shandong, la volonté de ses beaux parents et les caprices des wedding planners du coin. Les volontés s’opposent, le ton monte. Elle est trop moderne dans ce monde de traditions, trop influencée par l’Occident pour ces vieux Chinois patriotes. Quelques tensions avec son futur époux, qui hésite entre s’en ficher complètement ou prendre partie pour les traditions de sa ville natale. Elle veut des fleurs blanches ? c'est impossible. Un livre d’or pour que les invités émargent ? Ça ne s’est jamais vu dans le Shandong. Une cascade de Champagne ? Ce n’est pas traditionnel. Une robe rose pour la demoiselle d’honneur ? Il va falloir vérifier que ce n’est pas contraire aux traditions, car le rouge et le blanc sont formellement interdits. J’ai finalement droit à ma robe rose.
Avoir une témoin occidentale fait quand même tiquer tout le monde. Ce n’est pas stratégique, il ne faut surtout pas que la demoiselle qui accompagne la mariée soit plus belle que la mariée. Les organisatrices la mettent en garde : « Plus personne ne va vous regarder, tous les yeux seront braqués sur l’étrangère ! » Ça ne me dit rien qui vaille, Nono tient bon. La bataille est féroce, la mariée contrariée doit céder du terrain sur de nombreux points. Rien ne doit être innovant, surtout pas original, et en aucun cas différents des habitudes du Shandong. « Mais c'est ton mariage ! » Elle me regarde en acquiesçant. - C'est ce que je leur ai dit. Et tu sais ce qu’on m’a répondu ? « Un mariage, ce n’est pas le mariage pour la mariée, c'est une mise en scène qu’elle offre à ses invités. C'est comme tourner un film : il faut que le public comprenne, qu’il trouve ça beau. Tu ne peux pas choisir uniquement ce qui te fait plaisir. »
.
.
« Je ne comprends pas pourquoi, dans les films occidentaux, il y a toujours quelqu’un qui entre dans l’église au moment du mariage pour s’opposer à l’union ». En Chine, le jour de la cérémonie de mariage, les mariés sont unis officiellement devant le gouvernement chinois depuis bien longtemps. Le « vrai » mariage, celui qui correspond à notre union devant le maire, est pour eux une formalité. On va au bureau des mariages, rue du Bonheur à Pékin, on dépose un dossier avec quelques papiers officiels, l’employé d’administration imprime deux petits livrets comportant chacun la photo des mariés posant ensemble sur un fond rouge. Un pour elle, un pour lui. Validé, tamponné, en 5 minutes, le mariage est bouclé. Pour la cérémonie initiatique qui permet de faire un rite de passage et de marquer le coup, il faudra souvent attendre des mois. Les jeunes mariés se retrouvent, 5 minutes après, sur le trottoir, leurs permis à la main, en jeans et baskets, à se regarder : ils viennent de s’unir pour la vie.

Le gribouillage des noms et des numéros d'identité est de moi, ce permis ne ressemble pas à un chiffon en vrai.
.
.
Elle le connaissait depuis quelques mois, elle sortait d’une histoire un peu compliquée et décevante, c’était le bon. Mariage.
J’étais mignonne et sympathique, on s’entendait bien en cours, je m’intéressais beaucoup à la culture chinoise. Témoin.
C’est comme ça qu’a commencé la grande aventure qui m’a amenée, le week-end dernier à être ban niang dans un mariage chinois. Récit.
Le jour du mariage, les mariés étaient ensemble depuis environ 1 an. Nono est Pékinoise, professeur indépendante de chinois pour étrangers, moderne, mignonne. Lui est originaire d’un village du Shandong, arrivé à Pékin il y a quelques années, commercial dans une entreprise chinoise, d’une gentillesse à toutes épreuves. Ils se sont rencontrés à la faculté de chinois. Elle gagne environ 6000 yuan par mois, lui 2000. Encore beaucoup de familles chinoises ne supporteraient pas cette situation, mais leurs parents sont ouverts et assez libéraux. Pour des parents chinois.
Avant le mariage, ils n’ont jamais habité ensemble, c’est hors de question. Ce sera autorisé uniquement à partir du moment où ils auront leur permis de mariage dans les mains.
Leurs différences d’origine les ont amenés à prévoir un mariage en deux volets : une première étape dans le Shandong le 19 avril, une deuxième étape à Pékin le 1er mai.
Concernant l’organisation, en amont, comme tous les mariés chinois, ils se sont occupés des photos. C’est une chose dont on se débarrasse des mois avant en organisant, en studios, des poses en costumes photographiées par des professionnels. Les mariés sont maquillés, habillés, photographiés, retouchés, recadrés, encadrés, envoyés par mail, courrier, UPS à la famille et aux amis, déclinés sur des souvenirs et imprimés sur posters de toutes tailles. Ils sont beaux, ils sont frais, ils sont heureux et souriants.
Hier, premier cours de chorale en chinois.
En plus de galérer à déchiffrer les caractères (avec une noire à 112, tout de même), je découvre aussi un système de notation musicale complètement différent !
Me voilà experte es traduction sino-française de ... partitions !
(clic sur la photo pour agrandir)
.
En Chine, la journée de la femme revêt une importance particulière, et les entreprises, que l'on surveille déjà de près tout le reste de l'année sur la question de l'égalité hommes-femmes, sont tenues de faire un geste envers leurs salariées. Cette année, dans mon entreprise, plusieurs initiatives se sont superposées : celle du RH français, qui a décidé d'offrir une rose à chaque femme ; celle du service communication chinois, qui a préféré offrir de la nourriture.
Offrir de la nourriture à ses employés est une chose assez commune dans les entreprises chinoises : 月饼 (gâteaux de Lune) à l'automne, pommes de terre de Mongolie en guise de prime de Noël, légumes divers en fonction des arrivages et selon un calendrier parfois assez curieux.
L'idée de la rose, so frenchy, n'a pas séduit le service support qui a trouvé l'idée très étrange : un symbole d'amour offert par le Patron à toutes les femmes de l'entreprise? C'était choquant.
La synthèse de ces deux initiatives a été la suivante : en tant que femme, j'ai reçu 1 tulipe orange accompagnée d'une carte de vœux signée par le Président, ainsi que 2 kilos de noix, 3 kilos de haricots rouges, 3 kilos de farine de maïs, 3 kilos de millet et 70 œufs. Heureusement que je cuisine beaucoup, d'autres à ma place auraient été bien plus embêtés.
En vraie Française, je n'étais pas choquée par l'idée de la rose, mais bien embarrassé par toute cette nourriture, d'abord parce qu'il a fallu faire plusieurs voyages pour ramener tout ça à la maison, ensuite parce que je n'avais jamais cuisiné ni haricots rouges, ni millet, ni farine de maïs.
Une fois de plus, j'ai été sauvée par Mingou. Si vous aussi vous ne savez que faire de plusieurs kilos de haricots rouges, suivez le guide :
Préparez de la pâte de haricot rouge (豆沙 dousha) avec plein de haricots, plein de sucre, pas mal d'eau, et laissez cuire à petit feu 2 heures, après avoir porté à ébullition.
Mixez, puis mettez en bocaux.
Étalez cette pâte entre 2 couches du mélange suivant : 120g de farine, 90g de sucre blond, 150g de beurre salé fondu, 80g de flocons d'avoine. Enfournez 30 minutes à 180°C, retenez vous de vous jeter dessus avant refroidissement et dégustez sous un plaid avec une bonne tisane par une grise journée de fin d'hiver (c'est à dire après l'arrêt national officiel du chauffage...)
Et pour ceux qui ne savent pas quoi faire de 3 kilos de millet, sachez qu'il remplace parfaitement la graine de couscous et se marie à merveille avec le poulet des retrouvailles.
.
J'avais le projet sincère de vous parler plus amplement de cérémonie chinoise du thé jusqu'à cette terrible découverte : la blogosphère francophone ne m'a pas attendue pour créer des pages web consacrées au thé chinois. Et pire : il y a des bloggeurs mille fois plus érudits que moi sur la question. J'étais là, prête à vous faire partager mes trois connaissances sur les théières Yixing, et je réalise que d'autres l'ont déjà fait -et avec tant de connaissances et de style que je n'ose plus parler.
C'est à cause de ça que vous avez dû observer pendant plusieurs semaines la photo d'un poussin rose : pendant que je cherchais un moyen de me sortir de ce mauvais pas.
Qu'à celà ne tienne, je vais étaler ma culture en fine couche sur une toute petite tranche de pain, bien me garder de vous divulguer l'adresse de ces divines sources d'inspiration et vous parler du thé que j'aime.
Après tout, c'est la sensibiliThé de l'humain qui fait l'arôme du breuvage (principe n°1 de la pratique des thés kung-fu), mon blog aura forcément une autre saveur. Espérons qu'elle vous sera agréable au palais.
Pour parler de thé gongfu, j'aimerais d'abord vous présenter ses ustensiles. Cela va à l'encontre de toute logique dans la mesure où vous ne savez probablement pas ce qu'est la pratique gongfu, mais tant pis. Surtout que désormais, vous savez que si vous ne comprenez rien, vous pouvez aller voir ailleurs. Ahem.
Mon ustensile préféré (enfin, l'un d'eux), c'est le chahe 茶盒. Littéralement, c'est "la boite à thé", mais il faut plutot y voir un récipient qu'une boite (les amateurs de Kaamelott sont certainement pliés de rire à ce stade). Et comme ce serait trop simple, on peut aussi y entendre he 荷 qui signifie lotus. Parce que Bouddha, quand il porte un lotus, il prend la même position que quelqu'un qui porte une boite à thé. Avec un peu d'imagination, disons.
Même si cela manque de logique de débuter en présentant le lotus à thé, c'est quand même une des premières choses que l'on voit sur la table quand on prépare le thé (parce que les "vraies" boite à thé restent en cuisine). C'est en quelque sorte le plat de présentation. C'est là-dedans que l'on sent le thé sec. Et ça doit être beau et fonctionnel. Beau parce que c'est un lotus (ça se tient, comme explication?) et fonctionnel parce qu'à un moment donné, il va bien falloir transvaser le thé du lotus vers la théière et il vaut mieux alors que le lotus ait une forme adéquate. C'est une des raisons pour laquelle les Chinois ont évité le jerrican, la baignoire et le dé à coudre qui, certes, sont aussi des récipients, mais bien moins pratiques (pour cet usage en tout cas).
Le chahe est donc rond et harmonieux, avec un petit bec arrondi au bout. On apporte le thé sur la table dans le lotus, et au moment idéal, on le verse dans le récipient dans lequel on va infuser le thé à l'aide d'un autre ustensile dont je vous parlerai plus tard.
Mais les photos parlent d'elles même, et après tout, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant sur les 茶盒.
.