Relecture
.
Moins de deux mois avant la soutenance de mon mémoire sur les gongfu cha : une bonne occasion de tenir mes promesses en vous parlant enfin de thé. Et surtout, une bonne occasion pour moi de profiter de votre relecture critique. C'est le moment de vous exprimer dans les commentaires (ou par mail pour les timides) : orthographe, clarté, concision, etc., toutes les remarques sont les bienvenues.
Seul inconvénient pour vous : je n'écris pas dans l'ordre et je ne publie donc pas non plus les articles dans un ordre logique. Ca se trouve, vous découvrirez la définition du gongfu cha tout à la fin. Pauvres lecteurs.
On commence avec une petite typologie des thés chinois pour bien comprendre de quoi il s'agit.
Les feuilles de thé
Le thé : ne
nous méprenons pas sur ce que recouvre ici ce terme. Il ne s’agit pas ici de cette
infusion brune arrachée à un sachet et auquel il faut ajouter lait, sucre, ou
citron pour donner du goût, ni du liquide fort tiré d’un samovar ou du bol
d’eau bouillante sur lequel flottent quelques fleurs de chrysanthèmes comme on
en sert dans les restaurants chinois. Pour comprendre la cérémonie du thé, il
semble indispensable d’avoir une connaissance précise de l’objet traité dans
cette cérémonie. Si les thés chinois recouvrent des centaines de variétés de
thés de bonne qualité cultivés en Chine, on peut les regrouper en quelques
catégories permettant de mieux comprendre de quel objet il s’agit. En effet, le
gongfu cha est une technique de
préparation du thé élaborée pour les thés provenant de Chine et s’applique donc,
en général, à un nombre restreint de types de thés. Cependant, le gongfu cha n’est pas jaloux et accepte
volontiers de partager ses secrets : son objectif étant de magnifier le
goût du thé, n’importe quel thé peut être préparé à la façon gongfu. Mon Daarjeling first flush
exceptionnel n’est jamais aussi bon que quand il est préparé dans ma théière
Yixing.
Cela n’empêche que le gongfu cha tel qu’il est pratiqué au quotidien en Chine ne concerne que des thés cultivés dans quelques provinces du sud et de l’est de la Chine.
![]()
Avant de distinguer
les processus de fabrication des thés à partir des feuilles fraiches, rappelons
que, contrairement à ce que l’on entend fréquemment, la feuille de thé ne
provient pas simplement du Camelia sinensis dont il existe des dizaines de
variétés qui sont autant de cépages apportant au produit fini une palette de
saveurs extraordinaire. Les crus, les sols et les climats sont des éléments déterminants.
Revenons sur ces
catégories, essentielles à la compréhension de la cérémonie.
La feuille de
théier, une fois cueillie, subit certaines transformations. Celles-ci ont pour
but initial de rendre le thé plus facile à conserver et à transporter. Les
différentes techniques utilisées ont donné naissance aux différents types de
thés.
En Chine, les
étapes classiques de fabrication du thé sont les suivantes :
Le flétrissage : le thé est chauffé pendant
plusieurs heures, ramollissant ses feuilles et lui permettant de perdre une
partie de son eau.
La fermentation : le thé est ensuite fermenté, c'est
à dire exposé à des conditions de chaleur et d’humidité favorisant l’oxydation
enzymatique des feuilles. De la fermentation dépend largement la qualité du
thé : trop fermentées, les feuilles sembleront brûlées, peu fermentées,
elles risqueront d’être amères. Pour certains thés, comme le Pu’Er cuit, cette
fermentation a lieu dans une pièce spéciale garantissant un environnement
extrêmement humide (de 90 à 95%) et une température constante et élevée (autour
de 22°).
La torréfaction : les feuilles de thé sont passées à
la vapeur
Le roulage : les feuilles sont ensuite roulées,
ce qui permet de casser les cellules et de libérer les huiles essentielles
contenues dans les fibres.
La dessiccation : cette phase consiste à stopper la
fermentation des feuilles. C'est une étape délicate dans laquelle les feuilles
doivent être soumises à une ambiance sèche et à une température élevée pour ne
conserver qu’une très faible part de leur humidité (2 à 3%).
Le criblage : également appelée tamisage,
cette opération consiste à trier les feuilles selon leur grade et leur taille
pour en distinguer les différentes qualités.
Les feuilles sont
ensuite conditionnées.
Tous les thés ne subissent pas toutes ces étapes. On
classe les thés selon plusieurs critères. Le premier est la fermentation. On
distingue alors les thés non fermentés (绿茶thés verts), les thés partiellement
fermentés (乌龙Wulong)
et les thés totalement fermentés (红茶,黑茶thés rouges et noirs).
Ces trois
catégories peuvent à nouveau se subdiviser lorsque l’on ajoute le critère de
l’oxydation. On compte alors six catégories de thés :
- le
thé blanc : 白茶
Ce thé est souvent
intégré dans la même catégorie que le thé vert dans la mesure où il ne subit
pas de fermentation, mais son processus de séchage est différent. C'est le thé
qui subit le moins de transformation entre sa cueillette et sa consommation et
qui conserve le plus les propriétés des feuilles fraiches. Les jeunes feuilles
sont cueillies avec les bourgeons, séchées au soleil, puis à l’ombre, et
parfois torréfiées.
Quelques thés
blancs :
白毫银针Bai hao yin zhen
白牡丹Bai mudan
- le
thé vert : 绿茶
Les feuilles sont
flétries après la cueillette puis séchées dans des bassines de cuivre
(dessiccation) pour empêcher leur fermentation en détruisant les enzymes. Elles
sont ensuite roulées ou pressées.
Quelques thés verts :
龙井Long
jing
碧螺春Bi
luo qun
安吉白茶An ji bai cha
信阳毛尖Xin miang mao jian
黄山毛峰Huang shan mao feng
太平猴魁Tai ping you kui
- le
thé jaune : 黄茶
Le processus de
préparation des feuilles de thé jaune est semblable à celui du thé vert, à cela
près que les feuilles subissent une phase de fermentation post-enzymatique. Les
feuilles de thé destinées au thé jaune sont flétries, torréfiées et roulées
puis recouvertes d’un linge humide et rassemblée par petits tas dans des
conditions d’humidité extrême (80 à 90%) pendant une vingtaine d’heures. Après
leur oxydation, le processus se termine par une dessiccation.
Quelques thés
jaunes :
君山银针 Jun shan yin zhen
蒙顶黄芽 Meng ding huang ya
- les thés Wulong 乌龙茶
Le thé wulong est
un thé partiellement fermenté. Cependant, le pourcentage de fermentation varie
d’environ 12 à 70% faisant de ces thés « bleu-vert » une catégorie
vaste présentant des types de feuilles extrêmement différents. Après
flétrissage, le wulong est brassé dans de grands paniers et fermenté. Le
brassage permet d’abîmer les bords et d’augmenter la surface d’oxydation. Cette
fermentation est arrêtée par chauffage dans une grande bassine de cuivre.
Certains thés sont torréfiés, tous sont ensuite roulés, puis séchés.
Trois provinces sont principalement productrices de Wulong : le Fujian, Taiwan et le Guangdong. Ces trois provinces sont également les provinces où l’on pratique le plus le gongfu cha.
![]()
Quelques thés
Wulong :
铁观音jie
guan yin
大红袍
da hong pao
风凰单枞 feng huang dan cong
冻顶 dongding
- le thé rouge 红茶
C'est un thé qui a
subi une fermentation enzymatique. Après le flétrissage et le roulage, les
feuilles sont entreposées dans une pièce chaude et humide favorisant la
fermentation. Celle-ci est stoppée par le procédé de dessiccation. On rappelle
souvent que ce que les Chinois dénomment thé rouge et thé noir sont
généralement, en Occident, réunis dans une seule et même catégorie, celle des
thés noirs. C'est parmi les thés rouge que l’on trouve les thés fumés.
Quelques thés
rouges :
正山小种zheng shan xiao zhong (Lapsang Souchong)
祁門 qi men (Keemun)
- le thé noir 黑茶
Le thé noir, dont on connait principalement les Pu’Er, est un thé post fermenté. Le thé subit généralement une première fermentation avant d’être exposé à une atmosphère propice à l’oxydation des feuilles, créant une nouvelle phase de fermentation. Les thés noirs sont généralement produits dans le Yunnan, le Hubei et le Sichuan. Le processus de post fermentation étant été développé dans un but de conservation, ce sont souvent les thés noirs qui sont consommés dans les provinces ou pays éloignés des zones de production. C'est également pour cette raison que l’on peut trouver le thé noir sous forme de briques compressées qui facilitaient le transport à dos d’animaux.
En ce qui concerne
le Pu’Er, on en distingue deux sortes dont la post fermentation : le Pu’Er
cru et le Pu’Er cuit.
Pu’Er cru (生普洱) :
Après la
cueillette, les feuilles de thé sont flétries puis chauffées de manière à
neutraliser les enzymes responsables de leur oxydation. Les feuilles sont
ensuite séchées au soleil ou, si les conditions météorologiques ne le
permettent pas, séchés à faible température. Les feuilles sont séchées jusqu’à
enlever environ 90% de leur humidité. Elles sont ensuite triées et séparées
selon leur qualité, et mélangées en fonction de recettes propres à chaque
Maison. Les feuilles sont enfin passées à la a vapeur pour leur permettre
d’être compressées en briques sans se casser. Les galettes de thé compressées
sont ensuite stockées dans une atmosphère sèche pour leur permettre de
commencer leur processus de vieillissement. Ce stockage, qui nécessite beaucoup
de temps et de patience avant la consommation, fait la valeur de ce thé
mais a également conduit à développer de
nouvelles méthodes de post-fermentation qui accélèrent le processus.
Pu’Er cuit (熟普洱)
:
Le Pu’er cuit subit une fermentation accélérée après le flétrissage et le chauffage. Cette technique, développée dans les années 1970 permet en effet d’obtenir une post fermentation en temps record. Pour cela, le thé est placé en tas dans une salle très humide à température très élevée selon un principe rappelant celui de la fabrication du compost. Pour que les bactéries nécessaires à l’oxydation se développent, on arrose d’eau les tas de thé qui sont ensuite recouverts de bâches. Le thé sera régulièrement mélangé pendant les plusieurs semaines que durera la fermentation, puis il sera séché et conditionné.
La qualité
Stéphane Erler
détaille cinq critères qui sur lesquels se baser pour définir un bon thé :
- la
qualité des feuilles : leur couleur brillante et forte, leur densité sera
un gage de qualité. Le plus souvent, on étudie également les feuilles ouvertes,
après leur infusion, pour voir leurs caractéristiques, leur taille, etc.
- l’odeur : un
thé de bonne qualité dégagera une odeur pure et fraiche ou un mélange de
senteur complexe et raffiné. Le thé croit en valeur lorsque ses feuilles se
chargent d’odeurs de fleurs, de fruits et d’épices nobles et rares. Un thé qui
rappellera l’odeur acre de l’engrais utilisé pour le faire pousser (le soja par
exemple) aura peu de valeur alors que certains thés aux odeurs harmonieuses
comme le Wulong 肉桂 (Rou gui) de Wuyishan[1],
rappelant la cannelle ou les fleurs de narcisses, auront une grande valeur et
une saveur de qualité. Les thés Pu’Er, dont l’odeur est extrêmement
particulière, se chargent le plus souvent de parfums rappelant la nature :
champs après la pluie, terre, bois mouillé, etc. Plus les odeurs qui se
dégagent des feuilles rappelleront un matériau noble et s’éloigneront des
odeurs de fumier et d’animaux de la ferme, plus le thé pourra être considéré
comme étant de bonne qualité !
- la
persistance : la qualité d’un thé se reconnait également à la durée du
plaisir que ses arômes apporteront au palais. Comme pour le vin, la persistance
aromatique dépendra de la teneur en tanins du thé et de l’équilibre entre
l’acidité et le moelleux.
- La
concentration de l’infusion : certains thés très concentrés permettent de
tirer un très grand nombre d’infusions d’une quantité de feuilles donnée, alors
que d’autres thés ne pourront être tirés que quelques fois. Pour des raisons de
rendement évidentes, on préférera les thés les plus concentrés.
- La
pureté et l’harmonie : on loue généralement les grands thés pour la
complexité de leurs arômes mais la multitude de goûts différents dans un thé ne
doit pas aller sans un critère d’harmonie. Un bon thé a des odeurs et des goûts
pur et cohérents qui s’assortissent et donnent à l’ensemble un accord délicat.
[1] 武夷山

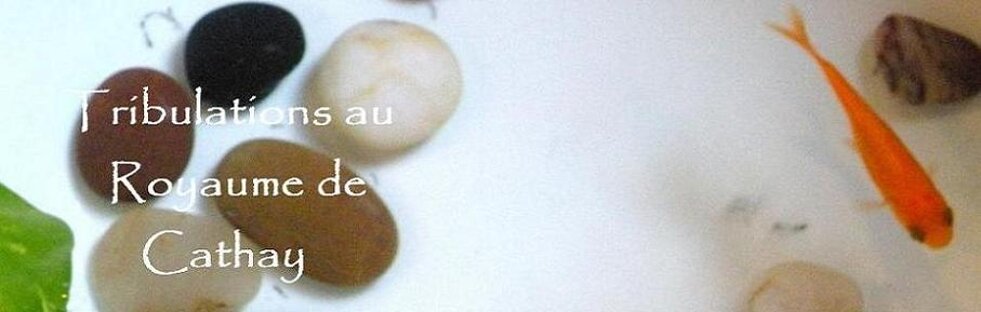
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F81%2F63%2F450178%2F38685335_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F16%2F40%2F450178%2F37245981_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F33%2F99%2F450178%2F35277047_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F27%2F450178%2F31980761_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F20%2F22%2F450178%2F30945056_o.jpg)








/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F53%2F20%2F450178%2F43312626_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F98%2F37%2F450178%2F42758730_o.jpg)